Francis GIAUQUE

Francis Giauque est né le 31 mars 1934 à Prêles (canton de Berne, en Suisse). Max, le père, est facteur et buraliste postal. Laure, la mère, tient le foyer. Giauque passe son enfance, sans histoires, dans son village natal. Le 20 avril 1950, l’adolescent, taciturne mais sans tristesse, plutôt brillant, frondeur, séducteur, impertinent et drôle, passionné de jazz, de sport, de cirque, de cinéma, de fêtes foraines et de lecture, entame des études à l’école supérieure de commerce de Neuchâtel. Il est décrit comme un être désinvolte et pince-sans-rire, féroce et sarcastique. On le craint pour ses réparties cinglantes d’une ironie subversive. Premières fêlures. La cassure n’est pas loin. En 1955, Giauque renonce à passer ses examens finals et se cloître dans la maison familiale. Il détruira plus tard les textes écrits à cette époque. Giauque veut gagner sa vie et s’assumer, mais la confrontation avec le monde du travail ne va pas sans heurts. À la solitude se sont ajoutés l’angoisse, l’alcool parfois. La crise est latente. Francis Giauque erre d’agences de placement en bureaux de rédaction. Les portes se referment sur ses attentes. Giauque écrit des poèmes, hante les boîtes de jazz, les quais des gares. Il écrit alors : « Je ne jouerai plus longtemps. Je ne continuerai pas une telle existence. » Le mal-être de Giauque ira en grandissant, dans cette société où l’on « se débat tous dans un étau qui ne lâche pas facilement sa proie. » Le poète aspire au départ afin de laisser derrière lui « la panoplie des échecs et des humiliations ». C’est aux alentours de sa vingtième année, que la certitude d’une exclusion irrémédiable s’empare de lui. Une lente asphyxie intérieure commence. Sentiment de culpabilité, alcool et drogues écraseront inexorablement le poète, révolté contre la société et la psychiatrie. Le thème quasi unique de son œuvre sera l’incommunicabilité, l’enlisement dans un « étau du silence » dont la seule issue, désirable, est la mort. Les images traduiront le calvaire comme une claustration dans un univers dur et muet, impénétrable, d’une glaciale obscurité. Journal de bord de sa descente irréversible dans les abîmes de l’être, la poésie est l’unique exutoire du poète jurassien, l’objet de sa survie, l’ultime rempart contre la maladie. Les seuls, parmi les hommes, qu’il reconnaît pour ses frères, sont les poètes maudits : « Le monde vit de nos charniers. C’est dégueulasse. Mes frères, je les nomme : Artaud, Prevel, Essenine, Nerval, Lautréamont, Poe, Hölderlin, Pavese, et toux ceux qui macèrent dans leurs souffrances au fond des salles de cure des asiles et des cliniques psychiatriques. » En 1956, Giauque s’installe rue du Calvaire, à Lausanne. Il travaille chez Payot comme libraire. Quelque temps après, il devient correcteur de nuit aux Imprimeries réunies. La violence qu’il éprouve à l’égard de la société, Giauque la dirige d’abord envers lui-même : « La révolte et la haine sont tombées et avec elles tout ce qui me tenait lieu de vie, mais l’autodestruction, cet insensé besoin de tout massacrer persiste et se propage en moi comme un cancer de plus en plus dévorant. » Il ne reste donc plus au poète que le langage et les mots. « Illusion », répond Giauque. Les mots sont aussi incapables de consoler que d’agir sur des plaies aussi vives, pour l’affamé qu’une lame aiguë – déchire au ventre. Ces mots, Giauque, les étire, nus, secs, exsangues, pour exprimer le mal qui le ronge. Soudain, en septembre 1958, Giauque obtient, grâce à son ami Hughes Richard, un poste d’enseignant à l’École Berlitz de Valence (Espagne). Il y dispense un enseignement de trente et une heures à des « greluches de la bonne société ». C’est à Valence, en décembre, que l’Angoisse le foudroie avec le plus de violence. « Recroquevillé sur son lit comme un enfant mort », il assiste, impuissant, à la décomposition de son être. Il revient à Prêles en catastrophe. L’écroulement sera d’abord physique, avant d’être moral, rapidement par la suite. Désormais, quels que soient les traitements auxquels il se soumettra en vain : clinique psychiatrique, cure de sommeil, cure d’insuline, électrochocs ou pyrétothérapie ou hallucinogènes, l’Angoisse est « prête à bondir comme une bête vorace. Toutes griffes dehors. » Parler seul, son premier recueil de poèmes, paraît à 300 exemplaires au printemps 1959. À la fin avril, le poète subit son premier internement psychiatrique à la clinique Bellevue, à Yverdon. Giauque va mettre un an pour refaire surface. En mai 1960, il travaille à nouveau comme employé de bureau à Neuchâtel, et écrit l’essentiel des poèmes qui seront recueillis dans L’Ombre et la nuit. De février à avril 1961, Francis Giauque suit des séances de psychothérapie : « Je me survis. J’essaie encore de lutter car l’instinct de vie se débat férocement en moi », note le poète. À partir du 14 mai, Giauque travaille (divers travaux de classement) à la Bibliothèque publique et universitaire de Genève. Cinq mois plus tard, paraît L’Ombre et la nuit, son deuxième recueil de poèmes. Le poète se débat de son mieux, jusqu’à l’usure. Giauque confie Terre de dénuement, à son ami, le poète Georges Haldas : « Si je devais me suicider, fais, je t’en supplie que ce recueil paraisse. Il pourra toucher je crois tous les malheureux qui n’ont plus d’espoir ou qui vivent dans l’univers de la souffrance. » La mère de Giauque meurt en juillet 1963. Il n’a désormais plus aucune attache et vivra reclus. L’adolescent frondeur, plein de vie, est désormais un être tassé, massif, inerte, rendu gonflé et bouffi par les médicaments qu’il absorbe en doses importantes. Le poète fait une tentative de suicide au début de l’automne. Il en réchappe, après cinq jours de coma, pour être interné dans une clinique psychiatrique à Yverdon. Angoissé, profondément révolté, dépressif, épuisé par trois tentatives de suicide, les traitements de choc et les médicaments, Francis Giauque met fin à ses jours, par noyade dans le lac de Neuchâtel, dans la nuit du 12 au 13 mai 1965. À lire : Parler seul (Éditions Nouvelle Jeune Poésie 1959 ; réédition Éditions des Malvoisins, 1969), L’Ombre et la nuit (Éditions de la Prévôté, 1962 ; réédition Éditions des Malvoisins, 1969), Terre de dénuement (éditions de l’Aire, 1968 ; réédition éd. Rencontre, 1980), Journal d’enfer (éditions Repères, 1978), Journal d’enfer et poèmes inédits (Papyrus, 1984), C’est devenu ça ma vie, lettres à Hughes Richard, (éditions Hughes Richard, 1987), Œuvres (éditions de l’Aire, 2005).
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Épaules).
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
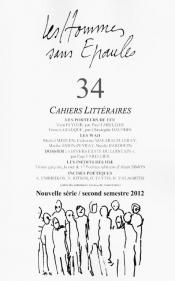
|
||
| Dossier : DIVERS ÉTATS DU LOINTAIN n° 34 | ||
